B. a. ba du remorquage électrique de loisir
27 juillet 2025
Alors que je vous informais dans mon dernier billet de l’avortement de mon site web consacré à mon projet de remorquage électrique de loisir, vous avez été plusieurs à souhaiter que, de temps à autres, j’utilise ce blogue pour vous informer de me constats et réflexion sur cette expérience qui se poursuit toujours. En juillet, dans le magazine Camping Caravaning, j’ai publié un texte relatant mes premières constatations se rapportant à notre descente vers la Floride, à la mi-décembre 2024.
Je sais que plusieurs lecteurs de ce blogue ne sont pas membres de la FQCC ou abonnés à Camping Caravaning. J’ai donc pensé qu’il serait opportun d’utiliser ce texte qui vous donnera une juste idée de nos premiers pas dans ce nouveau type de remorquage. Vous constaterez que cet article ne vise aucunement à faire la propagande du remorquage électrique, mais plutôt à donner l’heure juste sur les apprentissages, les difficultés et les compromis requis pour pratiquer une telle sorte de remorquage. Je vous rassure, encore aujourd’hui, le plaisir l’emporte encore sur tous les points problématiques. Voici donc dans sa version intégrale, le texte en question.
Au Canada, les Québécois mènent la parade en matière d’intérêt porté aux véhicules électriques. Une popularité en croissance continuelle grâce à la multiplication des bornes de recharge rapide sur notre territoire. Déjà, un grand nombre de caravaniers s’interrogent sur la faisabilité de pratiquer leur loisir à bord d’un équipage composé d’un véhicule tracteur électrique remorquant une petite caravane ou même une caravane à sellette. Théoriquement oui, la chose est envisageable, mais à condition de bien y réfléchir, de planifier ses voyages et surtout de faire preuve d’une grande adaptabilité.
Peu importe l’âge que l’on a, nous sommes issus d’une culture monolithique où le pétrole régnait en maître sur les moteurs automobiles ! Passer à l’électricité nous impose de plonger dans un monde nouveau, inconnu, dont les paramètres nous apparaissent mystérieux.
À titre d’exemple, la consommation d’énergie, habituellement exprimée en litres au cent kilomètres, devient un nombre de watts au kilomètre où, pour garder au moins un point en commun entre les deux échelles, un nombre de kilowatts au 100 kilomètres. Comment s’y retrouver alors que la plupart d’entre nous ignorte même combien de watts consomme son grille-pain ?
Les lignes qui suivent mettront de côté l’aspect scientifique et la complexité de l’électricité pour se centrer sur une expérience terrain vécue par l’auteur qui, depuis la fin de l’automne, se promène sur les routes nord-américaines dans un équipage composé d’un VUS et d’une caravane Alto fabriquée au Québec. Cet article décrira donc une situation incarnée dans la réalité, avec ses aléas, ses difficultés, ses points forts et ses plaisirs.
Consommation
Réglons dès le départ, la fameuse question de l’autonomie d’un équipage récréatif à carburant électrique. Majeur, ce point est également le plus difficile à mesurer. La façon de conduire (accélération et freinage brusques ou modérés), l’aérodynamisme du tracteur, mais surtout celui de la caravane, les conditions métrologiques (pluie, température, vents contraires ou portants), le relief géographique, la densité de la circulation (bouchons, ralentissements fréquents, travaux routiers) et, bien sûr la façon de conduire et la vitesse de croisière, sont autant des facteurs influençant la consommation en énergie.
Par contre, lors des décélérations, une partie de l’énergie cinétique est récupérée, transformée en électricité et retournée dans la batterie. Ceci, conjugué àune une vitesse de croisière plus tranquille et raisonnable ajouteront de précieux kilomètres à l’autonomie. Un moteur électrique l’emporte donc sur un moteur à combustion fossile qui, lui, lors d’un épisode de décélération, ne remet aucune goutte de pétrole dans le réservoir. Dans ce cas, le seul avantage d’un ralentissement mettant à profit la compression du moteur se traduira par une légère diminution de l’usure des plaquettes de frein.
Calculer l’autonomie réelle d’une voiture électrique, en mode remorquage ou non, s’avère assez complexe à établir avec précision. Cependant, en se basant sur l’historique de consommation généralement enregistrée dans l’application de la voiture, on peut assez aisément dégager une moyenne reflétant chacun des types d’usage (remorquage et solo).
L’ordinateur de bord de plusieurs voitures électriques permet aussi, habituellement, d’afficher la consommation moyenne selon la situation. Ainsi, on peut consulter la moyenne, exprimée en kW au100 km, depuis le jour où le véhicule a quitté l’usine. D’autre choix s’offrent également au conducteur qui peut opter pour la dépense en énergie depuis la dernière recharge, préférer un réglage manuel lié à un trajet précis ou calculé en mode solo ou remorquage.
Dans le cas de l’expérience que nous rapportons, régulateur de vitesse engagé et réglé à 95 km/h, la consommation, en mode solo, oscillait entre 18,5 et 21 kW/100km, selon les conditions environnementales. Cependant, celle-ci grimpait facilement à 30 et même 40 kW — par une température sous les 10º accompagnée de vents contraires de ±35 km/h — lors du remorquage, une augmentation pouvant facilement atteindre près de 50 %.
Apprentissages
Non seulement le calcul et la maîtrise des données d’autonomie requièrent une gymnastique avec laquelle le caravanier doit se familiariser, mais aussi de développer une capacité d’adaptation pour en arriver à un remorquage électrique récréatif efficace.
À titre d’exemple, lorsque l’on quitte notre territoire pour s’aventurer dans une autre province et aux États-Unis, on se heurte à une multitude de réseaux de recharge pour lesquels il faut souvent télécharger une appli propre à chacun des fournisseurs d’énergie. Cela implique qu'il se familiariser avec des consignes multiples en fonction des réseaux utilisés.
Après avoir s’être procurée une application, le conducteur s’ouvre un compte auquel on liera une carte de crédit. Souvent, un dépôt minimal sera exigé au compte qui sera automatiquement réapprovisionné dès qu’un seuil prédéterminé sera atteint. D’autres fournisseurs se contenteront simplement de débiter le montant de la transaction en temps réel. La procédure de branchement variera aussi d’un fournisseur à l’autre et quelques fois fera perdre beaucoup de temps au conducteur avant de la maîtriser.
Il faut également savoir que le prix facturé aux bornes varie énormément en fonction de la rapidité de la recharge. Ainsi, en Floride, le prix actuel au kilowatt est généralement de 56 cents en devises étasuniennes, ce qui avec le taux de change, les frais de change et administratifs correspondait durant l’hiver à près de 88 cents canadiens, environ dix fois le tarif résidentiel québécois.
Autre adaptation à laquelle il faut aussi se préparer, celle d’un temps de recharge, beaucoup plus long que pour un plein d’essence. Tout d’abord, il est fréquent de croiser des bornes de recharge où il est impossible de recharger le véhicule tracteur sans le séparer de la caravane. Lors de notre périple, cette situation se répéta environ 2 fois sur trois. Le temps de séparer les deux véhicules et de stationner la caravane à l’écart en prenant bien soin de ne pas oublier de la cadenasser et, plus tard, de faire le processus inverse avant de reprendre la route, contribue à allonger le temps requis pour se rendre à destination.
Il faut également prévoir que toutes les bornes puissent être occupées à notre arrivée à la station de recharge ou encore que certaines soient défectueuses. Heureusement, les applis développées par les fournisseurs de courant indiquent habituellement les bornes disponibles et en état de fonctionner. Par contre, malgré la puissance indiquée sur la borne, par exemple 350 kW/h, celle-ci sera divisée par deux si une autre voiture est branchée à la même borne.
Dernier irritant, non seulement le temps froid réduit sérieusement l’autonomie de la batterie, mais il rend aussi le boyau de recharge aussi malléable qu’une barre de fer, ce qui n’aide en rien à la facilité de le raccorder à la voiture.
En conclusion
Bien qu’en soi, voyager à bord d’un véhicule électrique se révèle une aventure fort agréable, celle-ci exige du conducteur un surplus de planification, beaucoup de souplesse et d’adaptabilité, mais aussi d’avoir constamment en réserve un plan B pour affronter des inévitables imprévus. N’oublions jamais qu’en aucun temps, la voiture ne s’adaptera au conducteur ni ne fera de compromis. Ces rôles incomberont entièrement à celui qui la conduit.
Le portrait de situation que nous venons de brosser peut sembler sévère et lourd de conséquences, mais après plus de 6 000 km de remorquage électrique récréatif, l’auteur ne reviendrait pas au carburant fossile. Finissons toutefois ce bref portrait par un point positif. En plus de quatre mois d’errance aux États-Unis et cinq terrains de camping différents, il lui fut toujours possible de recharger la batterie du VUS en ayant recours à la borne électrique de l’emplacement, et ce, sans aucun déboursé supplémentaire.




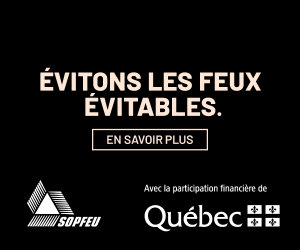
Commentaires
JC
Très pertinent tes connaissances Paul, je n'ai rien lu ailleurs avec autant de points à s'instruire avant de décider d'aller de l'avant pour un projet vr/auto tout électrique. Un livre sur tes expériences tout électrique deviendrait un ''best seller'' (enrichissement même pour les vendeurs) car qu'on le veuille ou non l'avenir sera électrique à moyen et /ou à long terme.
Pour nous faire part de votre commentaire sur ce billet, veuillez remplir ce formulaire.
*Seul votre prénom et commentaire seront publiés